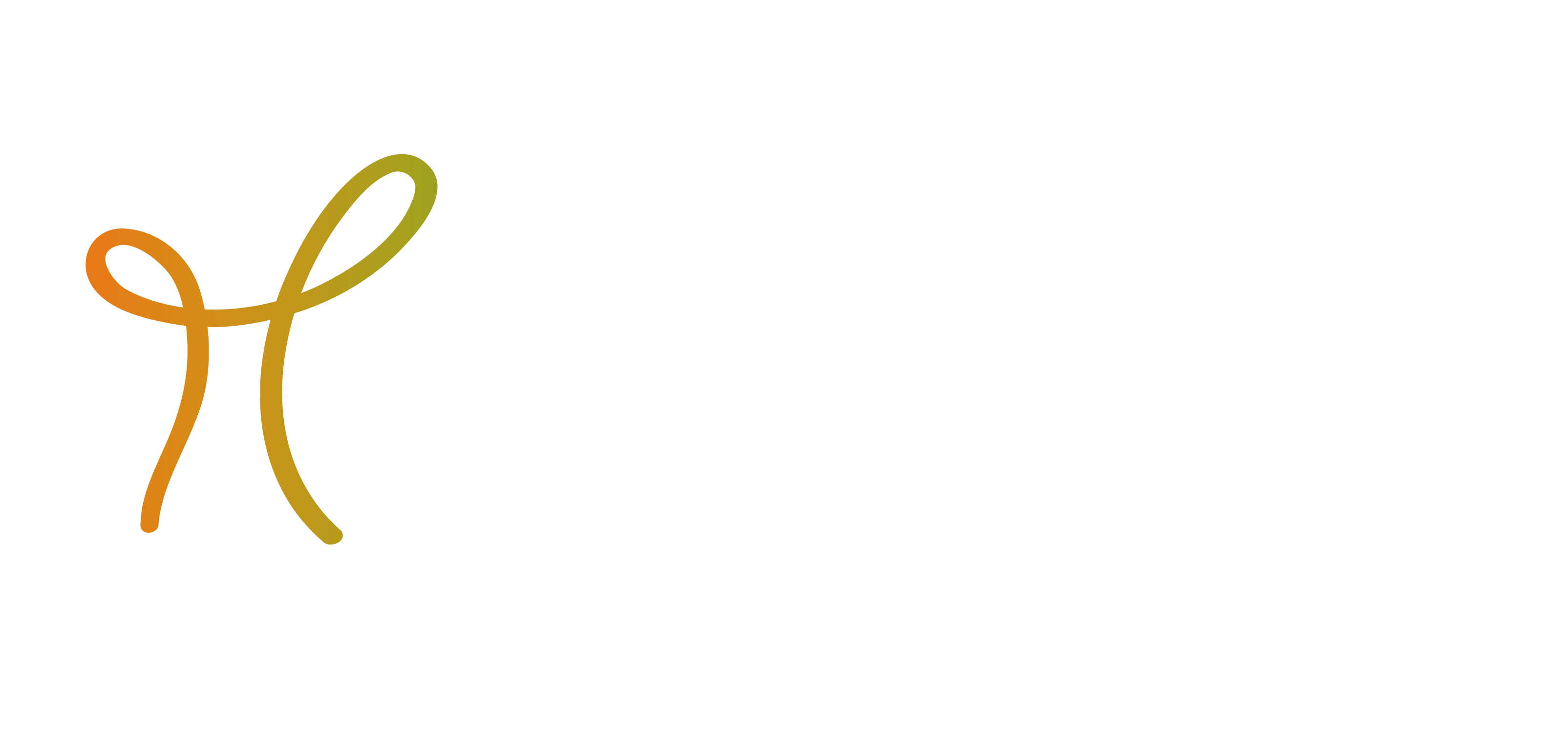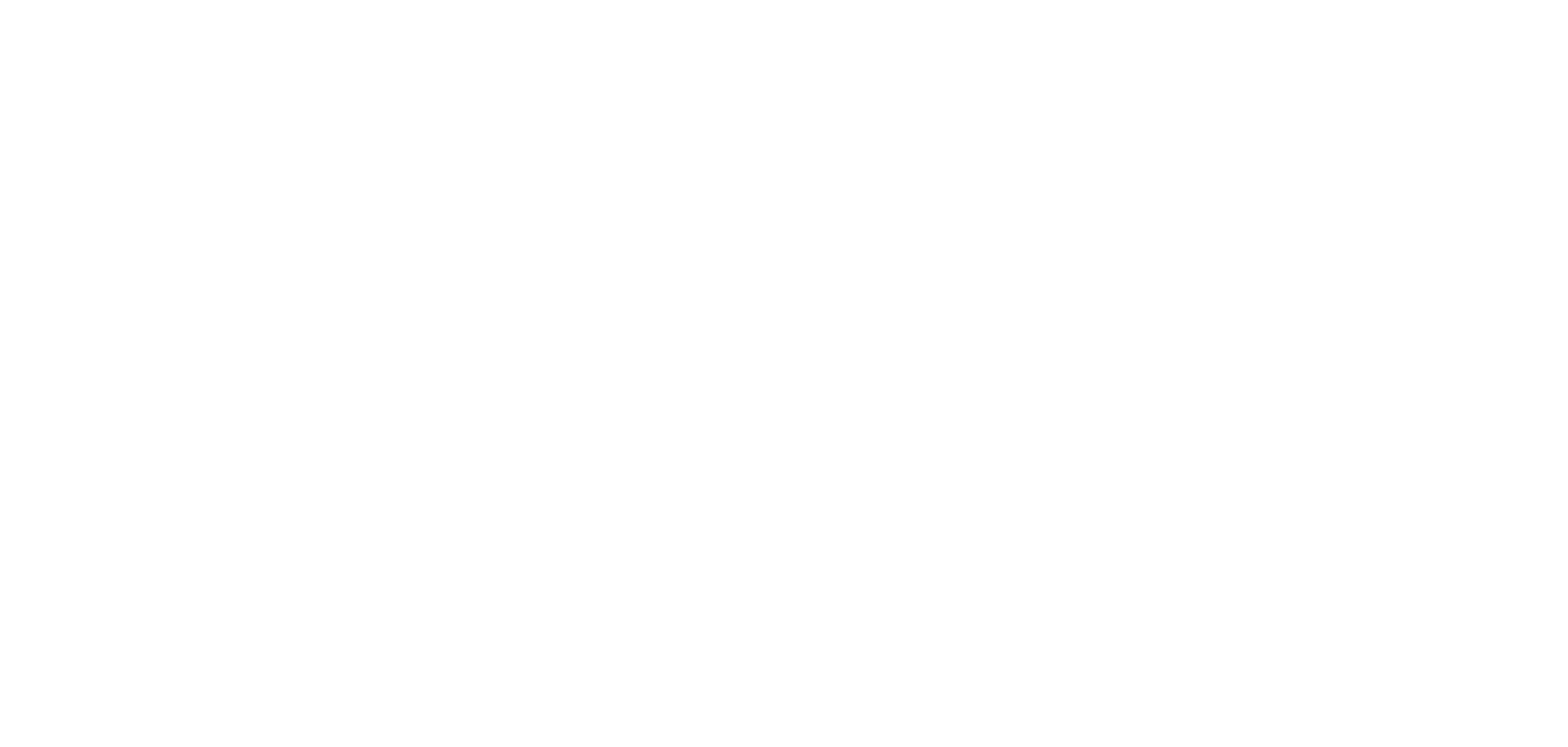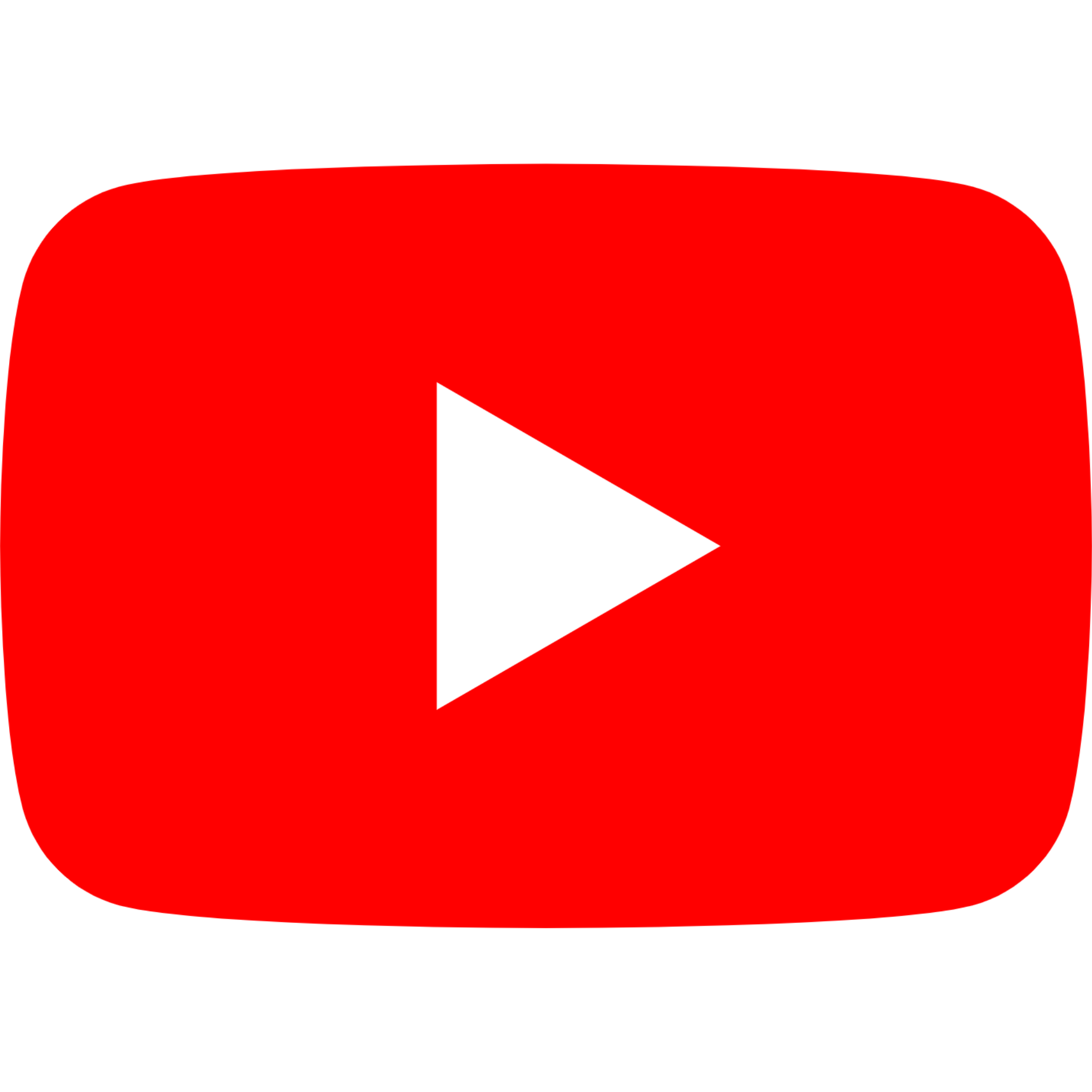L’engagement citoyen n’est pas une notion nouvelle en Afrique. Bien avant les cadres institutionnels modernes, nos sociétés organisaient déjà des formes traditionnelles de participation. Sous l’arbre à palabres, les anciens, pères de famille et figures respectées du village, se réunissaient pour débattre des questions d’intérêt commun, régler des différends, ou faire remonter les préoccupations de la communauté aux autorités coutumières.
Ces pratiques, bien qu’informelles et souvent masculines, constituaient les premières expressions d’un engagement civique africain, ancré dans le dialogue, la solidarité et la recherche du consensus.
À cette époque, les femmes, souvent exclues des cercles de décision, avaient néanmoins leurs propres espaces d’organisation : autour des points d’eau, dans les champs ou dans les tontines, elles structuraient des formes d’engagement social essentielles à la cohésion communautaire. Ces dynamiques, peu reconnues, étaient pourtant fondamentales pour la gouvernance locale.
Avec l’indépendance, la montée de la démocratie, et plus récemment l’essor du numérique, l’engagement citoyen s’est transformé. Il s’est formalisé, diversifié et digitalisé. De nouveaux outils permettent aujourd’hui aux citoyens de faire entendre leur voix à grande échelle.
Parmi ces innovations, la plateforme de participation citoyenne RéCi s’impose comme un modèle original et moderne. En facilitant les échanges entre citoyens, décideurs publics et organisations de la société civile, RéCi prolonge l’héritage des assemblées villageoises tout en l’adaptant aux enjeux contemporains de gouvernance. Elle permet de structurer les débats, de produire des recommandations collectives et de renforcer la redevabilité.
À travers cette plateforme, l’Afrique redonne vie à ses pratiques anciennes de concertation, en les dotant d’une portée nationale, inclusive et durable.